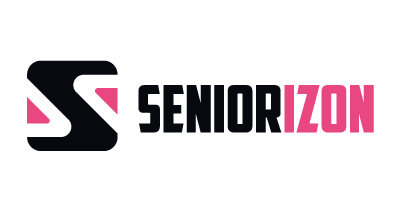Depuis janvier 2025, l’exonération de cotisations sociales sur les emplois à domicile ne s’applique plus aux prestations de bricolage et de jardinage, même réalisées par des organismes agréés. Certaines structures, pourtant titulaires de l’agrément “services à la personne”, voient leur champ d’intervention restreint à la suite d’une clarification réglementaire.
L’Urssaf a précisé que les prestations de surveillance temporaire ou d’assistance informatique ne donnent pas droit à crédit d’impôt dans tous les cas, malgré la persistance d’offres commerciales ambiguës. Ce cadre redéfini modifie les avantages fiscaux accordés et entraîne une révision des contrats proposés par les principaux organismes du secteur.
Panorama des aides ménagères en 2025 : ce qui change pour les particuliers
En 2025, le secteur des services à la personne subit des modifications concrètes. Les particuliers employeurs et familles regardent de près ce qui change pour l’aide ménagère à domicile et cherchent à savoir quelles prestations restent couvertes par le service public. Les interventions de nettoyage courant, l’entretien du linge ou l’aide à la préparation des repas demeurent dans le champ des aides classiques. À l’inverse, le bricolage, l’assistance informatique ou les petits travaux de jardinage s’effacent du dispositif.
Pour solliciter l’allocation personnalisée autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH), le conseil départemental reste l’interlocuteur incontournable. Ces aides visent les personnes âgées en perte d’autonomie ou les adultes handicapés atteints de pathologies chroniques. La demande se fait auprès des services sociaux du département. L’évaluation porte sur l’autonomie et les ressources du foyer. Les plafonds de financement ainsi que les modalités d’intervention s’adaptent à la situation familiale, au niveau de dépendance et à la nature du besoin.
Pour clarifier ce qui reste accessible et ce qui ne l’est plus, voici les prestations concernées :
- Services aide domicile : entretien courant, courses, préparation des repas.
- Exclusions 2025 : petits travaux de jardinage, bricolage, assistance administrative hors champ d’autonomie.
La aide sociale à domicile ne couvre plus les requêtes ponctuelles ou l’accompagnement administratif sans lien avec l’autonomie. Les familles qui cherchent ce type de soutien devront s’orienter vers d’autres structures. La France affine ainsi son système, concentrant l’effort sur les personnes âgées et les adultes en situation de perte d’autonomie.
Quelles exonérations fiscales sont réellement accessibles pour l’aide à domicile ?
Dans la réalité, le crédit d’impôt reste la principale aide pour les particuliers qui recourent à une aide ménagère à domicile. Ce mécanisme permet de récupérer 50 % des dépenses, dans la limite de 12 000 euros annuels (article 199 sexdecies du code général des impôts). Ce plafond grimpe à 15 000 euros pour les foyers avec un enfant ou lorsqu’un membre du ménage dépasse 65 ans. La déclaration en ligne simplifie la démarche, à condition de présenter les justificatifs délivrés par l’Urssaf ou l’organisme prestataire agréé.
L’exonération de cotisations patronales vise les particuliers employeurs âgés de plus de 70 ans ou ceux qui touchent l’allocation personnalisée autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH). Cette mesure, inscrite dans le code de la sécurité sociale, allège les charges patronales d’assurance sociale, les contributions sociales et la Csg. Seule la cotisation liée aux accidents du travail reste à acquitter.
Les allocations versées par le conseil départemental (APA, PCH) échappent à l’impôt sur le revenu et ne sont pas prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt. Leur utilisation ouvre droit à des exonérations ciblées, mais sans cumul possible avec d’autres avantages fiscaux. Quant à la TVA à taux réduit de 5,5 %, elle s’applique aux prestations facturées par des organismes agréés. Ce coup de pouce rend ces services plus accessibles, mais ne vient pas s’additionner au crédit d’impôt.
Organismes de services à la personne : fonctionnement, agréments et obligations
Le secteur des services à la personne rassemble de nombreux acteurs, mais tous n’opèrent pas sur le même modèle. Deux statuts dominent la scène : organisme prestataire ou organisme mandataire. Dans le premier cas, l’organisme embauche directement l’aide ménagère et prend en charge tout l’aspect administratif, social et salarial. Dans le second, c’est le particulier qui reste l’employeur officiel, responsable des déclarations et du paiement des charges, même si l’organisme l’accompagne dans ses démarches.
L’agrément délivré par l’État s’impose dans certains cas, notamment pour les services destinés aux publics sensibles, comme les personnes âgées ou en situation de handicap. Depuis la loi du 28 décembre 2015, obtenir cet agrément suppose le respect strict du code du travail et la formation continue des intervenants. Les services de l’État contrôlent régulièrement la qualité et la conformité des activités de services à la personne.
La législation oblige les organismes à jouer la carte de la transparence : devis écrit, explication des tarifs, détail des prestations, conditions de résiliation. La protection des données personnelles des bénéficiaires figure aussi dans les obligations, un enjeu qui ne faiblit pas dans le service public en France.
Pour mieux distinguer le rôle de chaque type d’organisme, voici un aperçu :
- Organismes prestataires : gestion complète ; un triangle entre bénéficiaire, salarié et structure.
- Organismes mandataires : accompagnement administratif, mais l’employeur reste le particulier.
Faire appel à un organisme non agréé revient à renoncer aux avantages fiscaux et sociaux associés aux services à la personne. Avant de signer, mieux vaut étudier de près la nature du contrat et les garanties avancées.
Limites, exclusions et points de vigilance à anticiper avant de faire appel à une aide ménagère
Avant d’engager une démarche auprès d’un service d’aide ménagère, il convient de se pencher sur les contours exacts des prestations prises en charge. Les limites diffèrent selon la source de financement,conseil départemental, caisse de retraite ou organisme privé,et la situation du bénéficiaire. Certaines interventions, comme le jardinage, la garde d’animaux ou l’entretien des espaces extérieurs, sont désormais hors du champ de la plupart des dispositifs publics, y compris l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et l’aide sociale à domicile.
La réglementation prévoit également des restrictions : dans le cadre de l’aide sociale hébergement, les familles dont un membre exerce déjà une activité rémunérée à domicile ne peuvent pas demander une intervention supplémentaire. Quant aux personnes âgées vivant en établissement, elles ne peuvent, sauf cas particulier, bénéficier à la fois d’une aide ménagère à domicile et d’une prise en charge collective. Les bénéficiaires doivent par ailleurs composer avec des plafonds horaires, ajustés selon le niveau de dépendance et les ressources déclarées.
Il est indispensable de se montrer attentif à la liste des exclusions : certaines pathologies ou situations, comme l’hospitalisation prolongée ou l’hébergement temporaire, peuvent suspendre ou limiter l’accès à l’intervention d’une aide. Avant de s’engager, prenez le temps de vérifier chaque clause du contrat, la part des frais restant à charge, et la cohérence entre le besoin réel et l’offre disponible localement, que ce soit à Paris ou dans les zones rurales. Les lignes bougent, les dispositifs évoluent : rester informé, c’est éviter les mauvaises surprises et choisir un accompagnement réellement adapté.